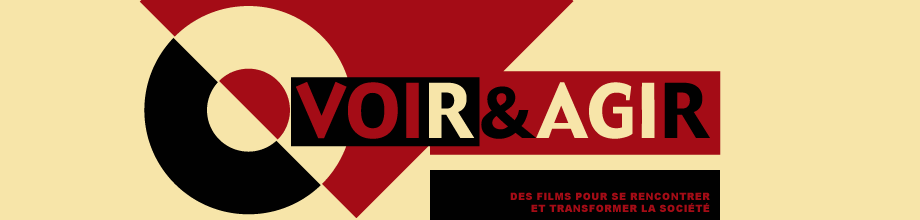
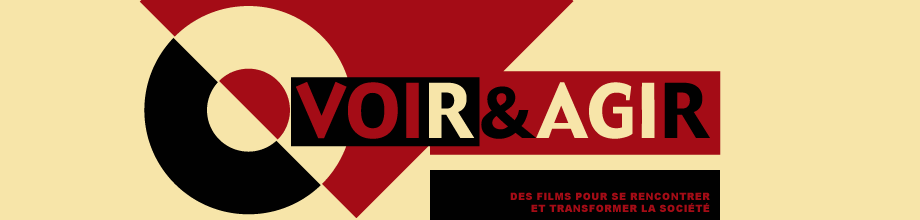
Thomas Faverjon est né à Besançon et se souvient que ses parents - tous deux employés de l’usine Lip - ont participé jusqu’à sa liquidation, à la lutte pour leur usine et leur emploi. Près de trente ans après la fin du conflit, il tente de comprendre ce que ses parents ont vécu et ont omis de lui transmettre.
Il s’agit, dans ce retour, de confronter ses souvenirs d’enfant aux analyses des anciens. Très vite, il se heurte au mutisme de son père et à la fuite de sa mère. Pourtant, dans le creux de leurs silences et au détour de quelques aveux, le fils finira à force de persévérance par délivrer sa mère de ses rancœurs.
Lip, c’est d’abord le souvenir du premier conflit, en 1973, celui du "trésor de guerre", des premières "ventes sauvages" du stock de montres, de la fronde des "paroissiens de Palente", des leaders de la lutte. Mettant en pratique démocratie directe et autogestion, la grève dans l’usine horlogère avait attiré à Besançon de nombreux cinéastes animés des idéaux de 1968 (Chris Marker, Richard Copans, Carole Roussopoulos...).
Pourtant la mémoire du conflit que Thomas Faverjon a reçu de ses parents ne coïncide pas avec la vision héroïque transmise par le cinéma militant.
Au risque de démythifier une lutte restée légendaire, il choisit de construire un autre récit, de l’intérieur. Il part du sentiment d’échec transmis par ses parents. Comme ceux-ci répugnent à s’expliquer, le réalisateur se tourne vers d’autres protagonistes du conflit Lip – militants CFDT, CGT, groupes Femmes, amis de la famille – pour reconstituer l’histoire en insistant sur le second conflit (1976-1980). À la différence du premier qui s’est conclu en 1974 par une victoire, le second, essoufflé et isolé, s’achève par le licenciement de la moitié des effectifs. En octobre 1979, à l’issue d’un vote des ouvriers en lutte, la mère du réalisateur se retrouve ainsi renvoyée au chômage. Beaucoup partent écœurés, un ouvrier se suicide.
Articulant l’histoire sociale à la chronique intime, le film traque les traces : des espoirs suscités par l’aventure des coopératives ouvrières de production jusqu’à son échec. Thomas Faverjon pose des questions dérangeantes, avec acuité et pudeur mêlées.
FICHE TECHNIQUE
Image : Gertrude BAILLOT et Thomas FAVERJON
Son : Emmanuelle VILLARD et Claire-Anne LARGERON
Montage : Florence JACQUET
Production : Anthony DONCQUE
CE QU’EN DIT LE RÉALISATEUR
Un entretien avec Thomas Faverjon dans le Magazine Images de la Culture n° 23 du CNC.
Sorti de La fémis en 2001 (département image), Thomas Faverjon a éclairé en tant que chef opérateur plusieurs courts-métrages et documentaires tout en se consacrant à la réalisation de son premier film Fils de Lip, présenté aux États généraux du film documentaire de Lussas en 2007.
Dans cet entretien avec Éva Ségal, comme dans celui avec Jérémy Forni à propos du film Trace de luttes (Images de la culture n° 22), nous retrouvons l’effort d’une génération pour comprendre les conflits ouvriers dans lesquels leurs parents se sont engagés et qui ont profondément marqué leur enfance.
Comment vous est venue l’idée de Fils de Lip ?
Thomas Faverjon : C’est une longue histoire. Le travail s’est étalé sur sept ans – la durée moyenne d’une psychanalyse ! L’envie est née quand j’ai vu
La Reprise d’Hervé Le Roux. J’ai pris conscience que moi aussi, j’avais une histoire. Jusque-là, j’avais le sentiment d’avoir participé, à travers l’histoire de mes parents, à l’histoire d’une usine, mais pas à celle d’un conflit. En 1978, j’avais six ans et ma mère travaillait à Lip. Elle ne m’avait pas expliqué qu’elle était en lutte et que ce n’était pas une usine comme les autres. Je croyais que c’était normal que les ouvriers fassent des tours de garde le dimanche pour garder l’usine. Il y avait une garderie et tout le
monde se connaissait. J’ai eu d’abord envie de faire un film pour montrer à ma mère que ce qu’elle a vécu – et dont il lui restait surtout une souffrance, une dépression – était positif, glorieux, épique.
Concrètement, comment a commencé votre travail sur le film ?
T.F. : À partir du moment où je suis rentré à La fémis (1997), je suis parti à la recherche de films militants sur le conflit Lip. J’ai d’abord trouvé le film de Dominique Dubosc, Lip 73, mais ce film ne parlait que du premier conflit, et j’avais essentiellement vécu le second (1976-1980). J’ai cherché plus loin en remontant les circuits militants, mais ce n’était pas encore le bon moment.
Pourquoi votre première démarche a-t-elle été de rechercher des films alors que vous étiez, d’une certaine façon, un témoin direct et que vous pouviez facilement rencontrer tous les protagonistes ?
T.F. : Sans doute parce qu’à cette époque j’avais tendance à voir le monde à travers le cinéma, parce que je vivais à Paris, et, surtout, parce que c’était compliqué d’en parler avec mes parents. Quand je disais que je voulais faire un film sur Lip, on me répondait c’est du passé, tout a été dit. Je voulais savoir ce que racontaient les autres, commencer par
l’extérieur avant de rentrer à l’intérieur. J’avais entendu parler du film de Chris Marker et Roger Louis, Puisqu’on vous dit que c’est possible, et
des films de Carole Roussopoulos, mais je ne les ai pas trouvés tout de suite. J’ai commencé à écrire, à demander des aides. J’ai obtenu la bourse
Brouillon d’un rêve de la Scam. Après plusieurs temps d’enquêtes qui ont abouti dans des impasses, j’ai recentré le projet sur mes parents. En 2003,
j’ai commencé à tourner des entretiens. Ce dont les gens me parlaient, c’était toujours du premier conflit et ça ne ressemblait pas du tout à ce que j’avais ressenti. Ils racontaient un combat victorieux, glorieux, alors que mes parents m’avaient transmis un sentiment complètement opposé.
Vos parents étaient restés sur un sentiment d’échec ?
T.F. : Évidemment, d’où leur réticence à en parler. Malgré mon insistance, j’avais l’impression qu’ils ne me disaient pas tout, en tout cas que leur mémoire ne coïncidait pas avec l’Histoire. Ils me disaient qu’ils ne savaient pas en parler, qu’il valait mieux demander aux autres. Dans ces premiers entretiens, j’insistais pour aborder toute l’histoire, y compris
celle du second conflit. Les premiers tournages étaient encourageants avec beaucoup de scènes très vivantes. Du coup, je me suis décidé à contacter Chris Marker. Son film est justement réapparu à l’occasion du trentième anniversaire du conflit, en 2003, et j’ai pu enfin le voir. J’ai réussi à voir
quelques films de Carole Roussopoulos, qui montraient un point de vue de femmes. Monique, filmée en 1973 et en 1976, est un personnage à part, très exceptionnel. Avec Christiane et d’autres qu’on voit dans Jacqueline et Marcel, elle représente à l’époque une minorité révolutionnaire, réellement engagée dans l’autogestion.
Puis je vais découvrir À pas lentes de Richard Copans, tourné avec le collectif Cinélutte. J’ai pu ressortir la copie qui se trouvait dans la cave des
Films d’Ici et la faire transformer en télécinéma. C’est un film magnifique, centré sur la prise de conscience des femmes ! J’ai retrouvé aussi dans
les archives du PCF place du Colonel Fabien Lip, réalités de la lutte, d’Alain Dhouailly, produit par la CGT, un film qui était le pendant de celui de Chris Marker. Marker avait travaillé avec Scopcolor, un groupe intéressé par l’autogestion. Comme la CGT n’approuvait pas son montage, elle est sortie de Scopcolor et a fait un film de style très différent qui accorde la première place aux discours prononcés par les leaders CGT.
Je suis aussi tombé sur un film qui montre les actions théâtrales, notamment la création du spectacle Arthur, où as-tu mis les montres ? par la troupe Z, à Besançon en 1976. Après beaucoup de recherches, j’ai encore trouvé un film tourné par les ouvriers, Lip 76, qui évoque le début du second conflit, et un autre réalisé par le CNDP, qui montre l’usine vide en 1983 et parle des comédiens en usine.
Lip a été un des conflits les plus filmés mais sans doute manquait-il encore un film personnel ?
T.F. : Je n’avais pas conscience que tant de films avaient été tournés. Je les ai découverts, d’une certaine manière, comme des films de famille. J’y retrouvais une part de mon histoire, des gens que je connaissais. Nous habitions à Palente juste en face de l’usine, les CRS campaient au pied de
l’immeuble. Je ne savais pas que cette histoire avait passionné tant de monde, qu’elle avait tenu la une des actualités télévisées. Mes parents allaient à l’usine, ils étaient en grève mais ne me l’expliquaient pas. Tous ces films militants m’ont permis de comprendre l’importance du conflit et sa face victorieuse. Ils montraient une ambiance extraordinaire. Mais, mis à part les films de Carole Roussopoulos, spécialement Jacqueline et Marcel, les contradictions du second conflit n’ont pas été abordées.
Dans À pas lentes, qui s’intéresse plus aux femmes qu’au conflit, on voit le groupe Femmes parler avec les leaders syndicaux. Je trouvais cela très positif, mais Christiane, une des animatrices de ce collectif, m’a révélé que cette rencontre avait été mise en scène pour le film. Selon elle, les femmes parlaient à l’intérieur du groupe mais elles restaient inaudibles dans les assemblées générales et au niveau de la direction du mouvement.
Entre le projet de départ et le film abouti, il y a une grande différence. À l’arrivée, n’est-ce pas surtout un film autour du silence de vos parents ?
T.F. : Le prix à payer pour mes parents a été lourd. Dans leur CV, il y avait un trou de 1977 à 1981, les quatre années où ils avaient été rémunérés par l’usine en lutte. Bien qu’ils n’aient pas été des meneurs, ils étaient considérés comme subversifs, “bolcheviques”, et il leur était très difficile de
retrouver un travail. Pendant quatre ans, ils s’étaient battus avec pour seul objectif la défense de l’emploi. J’avais envie de leur demander pourquoi ils n’avaient pas lâché le conflit en cours de route. Ils m’ont donné plusieurs réponses, mais au fond je pense que ma mère – même si elle ne veut pas le reconnaître – a trouvé là une famille, des relations très fortes entre les gens.
Vous avez cherché des témoins susceptibles de compléter l’histoire de vos parents ?
T.F. : Oui, et j’ai trouvé des gens très généreux. C’était un échange, je donnais et ils me donnaient ; mais certains ont refusé de parler car le deuxième conflit avait laissé des blessures. J’ai eu une longue période de tournage en 2005 et j’en suis revenu très abattu. C’est grâce au travail avec ma monteuse que j’ai trouvé enfin le sens du film. Je suis retourné
voir les gens en leur disant “maintenant que vous m’avez raconté votre histoire, je vais vous raconter la mienne”. Dans mon sac à dos, j’avais trois
éléments : le premier c’était les films militants, la face victorieuse, joyeuse, qui va jusqu’en 1976 et un peu au-delà. Le deuxième, c’était l’article de journal où il était question de ma mère au lendemain du vote d’octobre 1979, où elle se retrouvait dans le groupe C, renvoyée à la case chômage. Cette coupure de presse, elle l’avait toujours conservée à la maison, signe que quelque chose n’allait pas. Le troisième élément, c’était le faire-part publié dans Lip Unité du décès d’un ouvrier qui s’était suicidé. La joie, la tristesse et la violence. Dès notre première rencontre avec Jacky, il est apparu non seulement qu’il avait partagé la même histoire mais qu’il
pouvait me l’expliquer.
Il s’agissait pour vous de comprendre l’origine de la souffrance des Lip après le conflit ?
T.F. : Tous ont subi une forme de dépression après toute cette énergie qu’ils avaient donnée pendant quatre ans. La blessure vient de ce qu’ils avaient fait le choix de continuer ensemble dans le cadre des coopératives ouvrières de production, mais l’État ne l’a accepté que sous la condition que la moitié soit licenciée. Les leaders ont cédé au nom de la raison
économique ; après trois ans de lutte, ils ont voulu sortir de l’illégalité et la dynamique s’est essoufflée. Par rapport à 1973, la conjoncture avait changé. Après le deuxième choc pétrolier, le chômage s’étendait, les luttes contre les fermetures d’entreprises se multipliaient et tout le monde comptait sur la victoire de l’Union de la gauche aux législatives de mars 1978. Les Lip ont lancé les coopératives en espérant que la gauche, une fois arrivée au pouvoir, les aiderait. Après la défaite électorale, ils ont été obligés de négocier la survie des coopératives avec 30 000 personnes qui travaillaient à l’île Seguin et le gouvernement de Giscard. Au départ, le plan présenté par le collectif de lutte prévoyait d’intégrer progressivement sur six ans les 470 Lip qui étaient restés et se trouvaient “porteurs de parts” dans les coopératives. Mais l’État a fait la sourde oreille, n’acceptant de négocier qu’avec le directoire de coopératives et pas avec les meneurs de la lutte. Il a imposé ses conditions : quitter Palente, se séparer, évincer la moitié des travailleurs. On est arrivé à la définition de trois groupes : A pour la production industrielle (micromécanique,fabrication des montres…) ; B pourdiverses activités de service assez novatrices pour l’époque (imprimerie, tourisme culturel, restaurant…) ; et C, ceux qui devaient partir. Ma mère avait travaillé au restaurant, puis à l’épicerie ; en octobre 1979, elle s’est retrouvée dans le groupe C, C comme chômage.
Le titre de votre film suggère que vous vous sentez l’héritier d’une époque, d’une lutte…
T.F. : Par rapport à mes parents, je me sens plus intéressé par l’utopie, plus conscient. Pas révolutionnaire mais utopiste. Je suis attaché à l’idée qu’un autre monde est possible à partir du collectif, en s’appuyant sur d’autres relations. Ce n’est pas le pouvoir qui m’intéresse mais la transformation des
rapports. Le but de mon film n’est pas de retracer une histoire mais de s’ancrer dans le présent. Je tâche de comprendre si la tristesse de mes parents est fondée, et aussi pourquoi moi, je n’agis pas. J’appartiens à la première génération qui a su qu’elle n’échapperait pas au chômage et qui, d’une certaine façon, en a pris son parti. Par provocation, je justifiais un peu comme ça mon choix de faire des études de cinéma. C’est un film sur ma génération, pour essayer de comprendre sa difficulté à s’engager dans des luttes.
Votre engagement passe sans doute par le cinéma mais d’une autre manière que pour la génération de Chris Marker ?
T.F. : Je rêverais de faire des films de lutte héroïques, romantiques, comme ceux de Chris Marker, mais j’en suis incapable. D’autant que j’ai vécu l’échec des luttes de l’intérieur. Et encore une fois, ce n’est pas tant un échec face au patronat qu’une véritable cassure interne lorsque des délégués syndicaux décident eux-mêmes des salariés à éliminer. La plupart des Lip ont perdu leurs illusions et moi aussi du même coup. Je me suis toujours senti proche des ouvriers en lutte mais le but de mon film est surtout que les gens se posent des questions. Mon engagement est plutôt dans le domaine des idées et je pense qu’à ne montrer que le côté héroïque et victorieux des luttes, on s’enfonce encore plus dans la dépression, en tout cas, on ne peut plus avancer. Ce film vient d’une envie de comprendre mon héritage mais pour le transmettre. Je pensais même l’adresser à mon fils – pour l’instant imaginaire – et n’être qu’un passage de témoin. Nous avons besoin d’écrire, en face de l’histoire officielle ou publicitaire, une histoire des gens qui ont produit ces richesses. Il y a l’histoire officielle de Renault, et l’histoire des 30 000 personnes qui travaillaient à l’île Seguin et qui ont fait cette marque. Tous les Lip que j’ai filmés avaient des histoires personnelles passionnantes à raconter. Avant d’arriver chez Lip, une usine assez privilégiée à l’époque, ils avaient eu des parcours très durs, de nombreuses femmes par exemple avaient été domestiques dès l’âge de 12 ou 14 ans. En travaillant sur Lip, je crois que j’ai mieux pris conscience des rapports de classe. J’ai beau être d’une certaine manière un intellectuel, je me sens appartenir à la classe ouvrière. Le cinéma militant que j’ai envie de faire est un cinéma qui partirait de
moi, de mon expérience les pieds sur terre, de ce que je peux faire et qui amènerait à se poser des questions.
Par rapport à la Rodhiaceta et à Peugeot où le groupe Medvedkine s’est constitué, l’expérience des Lip avec le cinéma est-elle très différente ?
T.F. : Oui. Durant le premier conflit, la commission cinéma de l’usine était dirigée par Dominique Dubosc qui avait déjà tourné en Amérique latine et
pendant la grève à Pennaroya. Apparemment, il n’a pas formé de cinéastes parmi les Lip. La manière dont Carole Roussopoulos a utilisé la vidéo est
aussi très intéressante. Par exemple elle projette les séquences tournées dans l’intimité devant un public plus large réuni à l’usine et filme les réactions comme dans Jacqueline et Marcel. Mais à ma connaissance, les Lip ne se sont pas approprié les outils du cinéma, enfin pas directement.
Monique, cette militante féministe filmée par Carole Roussopoulos, occupe aussi une place essentielle dans votre film puisque vous lui laissez le mot de la fin.
T.F. : C’est une personne que j’aime beaucoup et qui justifierait à elle seule un film. En fait, elle apparaît au début du film dans le contexte du premier
conflit avec un langage très positif et “victorieux”. Mais je lui coupe la parole dans le montage, pour la faire réapparaître à la fin où elle tire un bilan très critique, avant même le vote d’octobre 1979. Je lui ai demandé de relire trente ans après les mots qu’elle avait dit lors d’un entretien pour Commune, bimensuel du comité communiste d’autogestion, en date de juin 1978, où elle expliquait les raisons de son départ de la lutte de Lip. Mon film va de l’intime au politique et Monique parvient à exprimer cet aspect politique.
Cette manière de nouer l’intime et le politique est effectivement une des grandes réussites de votre film.
T.F. : On peut aussi parler d’une dimension psychanalytique puisque je pars du non-dit, d’un héritage qui ne m’est pas transmis. Je tâche de comprendre ce qui bloque, pourquoi mes parents ne peuvent pas mettre des mots sur ce qu’ils ont vécu. Dans la construction, il y a donc d’abord les parents, puis le récit de ce qui a fait souffrir ma mère, je lui fais entendre les mots des autres pour qu’elle puisse mettre des mots sur sa douleur. Ensuite vient le côté politique avec Monique. J’ai toujours été intéressé par les films à la première personne. Je pense à Histoire d’un secret de Mariana Otero ou à Retour à Kotelnich d’Emmanuel Carrère. Je ne voulais pas que la voix off soit un “moi je”, du coup j’exprime un fantasme en disant ce que mes parents auraient pu me raconter, me transmettre. Ce n’est qu’à la fin que je prends la parole en mon nom propre. Il n’y a pas de secret de famille comme dans le film de Mariana Otero mais une histoire qui a profondément marqué la famille et qu’on n’a pas su expliquer. Avant de tourner ce film, je ne me rendais pas compte du poids de souffrance qui pesait sur mes parents…et sur moi.
Bien qu’ils aient participé à ce long conflit, ils ne semblent pas avoir acquis ce qu’on appelle une “conscience politique”.
T.F. : Ils ont été dans la lutte pour des raisons plus immédiates, pour rester avec les autres, mais aussi pour défendre leurs idées. Face à une partie de la famille qui ne croyait pas au succès de cette forme d’action, ils devaient en permanence justifier leurs choix. Ces discussions à l’intérieur des familles souvent sceptiques ou hostiles, tous les Lip les ont vécues. Mais cela n’a pas conduit mes parents à se politiser davantage. Ils se battaient avant tout pour garder un emploi et s’étaient syndiqués à la CGT sans que ça exprime un choix réfléchi, d’autant que ma mère était à cette époque catholique pratiquante. Elle a perdu en même temps ses convictions syndicales et religieuses !
Dès le début de ce projet, j’ai voulu faire un film pour ma mère. Un peu moins pour mon père parce qu’il a été embauché dans les coopératives et a pu conserver un emploi plus longtemps. Pour les femmes, le combat a été beaucoup plus marquant, et pour nombre d’entre elles, il a créé l’occasion
d’une première prise de parole. On le voit bien avec Monique et surtout Christiane dans le film de Carole Roussopoulos. C’est aussi très présent dans Jacqueline et Marcel. Dans la lutte, ces femmes ont pris confiance en elles et compris que leur parole valait autant que celle d’un intellectuel quand elles exprimaient une expérience personnelle. Ma mère était trop complexée, trop timide pour aller aussi loin, mais elle a partagé cette libération de la parole avec les autres.
Après Fils de Lip, envisagez-vous un prochain film plus politique ou plus intime ?
T.F. : Je n’ai pas envie de dissocier les deux. La question que continue à me poser Lip, c’est celle de la démocratie. Ça apparaît clairement après le vote
du 3 octobre 1979. Jusque-là, les articles dans Lip Unité n’étaient pas signés. À partir de ce moment de rupture, chacun reprend ses positions et les noms apparaissent. Dans les colonnes du journal se développe entre les leaders du mouvement un débat très intéressant sur la démocratie, avec
Fatima, Jacky, Charles Piaget. Chacun parle en son nom et ils s’opposent sur la question de la pratique au sein des coopératives. Ces textes sont tellement passionnants que j’ai eu un moment l’envie d’en tirer une pièce. J’aimerais revenir sur la pratique concrète de la démocratie au sein des luttes et dans la société. Comment instaurer un ordre sans en même temps imposer un pouvoir ? Voilà ce qui m’intéresse.
Propos recueillis par Éva Ségal, novembre 2007.
1. Puisqu’on vous dit que c’est possible, de Chris Marker,
1973, 47’.
2. Jacqueline et Marcel, réalisation collective, 1975, 61’.
3. À pas lentes, de Richard Copans avec le collectif Cinélutte,
1979, 40’.
4. Lip, réalités de la lutte, d’Alain Dhouailly, 1974, 32’.
Télécharger le Magazine Images de la culture n° 23 (pages 48 à 50) sur le site du CNC